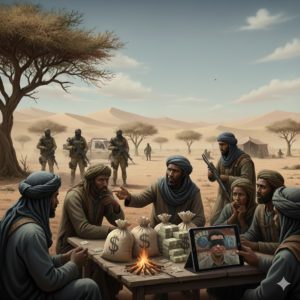 Paul Amara, consultant, Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel Sahara, Centre 4s.org
Paul Amara, consultant, Centre des stratégies pour la sécurité du Sahel Sahara, Centre 4s.org
Au Sahel: faut-il ou non payer des rançons aux djihadistes, pour libérer les otages étrangers ? Ce débat a cours au moins depuis 2003. Payer, c’est avoir des chances de sauver des vies, mais c’est aussi encourager, voire perpétuer cette pratique. Certes un vieux débat. Refuser de délier les cordons de la bourse équivaut parfois à signer la mort des otages. Compte tenu de la complexité de l’opération, tôt ou tard, les pays finissent par manier les deux méthodes, quitte à ne pas dévoiler ce qui s’est réellement passé en coulisses. Le trafic d’otages reste un commerce florissant. Grâce à lui, les Groupes terroristes achètent des armes, recrutent de nouveaux adeptes et perpétuent le système.
Le 30 octobre 2025, les Émirats Arabes Unis auraient versé au Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), près de 50 millions de dollars et l’équivalent de 20 autres sous forme d’armes et de munitions, afin de libérer des otages. Ceux-ci comprennent un important général de réserve, résidant au Mali. Il était avec deux compagnons : un Pakistanais et un Iranien. Les trois otages furent enlevés, le 23 septembre 2025, à Sanankoroba, cercle de Kati, à 40 km au sud de Bamako. L’accord de libération inclut celle de 25 djihadistes incarcérés au Mali ainsi que des facilités de déplacement à l’étranger. Pour sauver la face aux autorités maliennes, le GISM, se serait engagé à libérer des notables et des militaires prisonniers.
En difficulté, l’Alliance des États du Sahel (AES) dit redouter l’impact de la redistribution de cette rançon record. Iyad Ag Ghali aura toute latitude de verser des primes à ses combattants et autres partisans. Une partie de la manne ira sans doute aux Katibas déployés en position avancée au Mali, Burkina Faso, Niger et Nigéria. L’argent ruissellera jusqu’à la frontière béninoise, où le GSIM combat son rival de l’État islamique au Sahel (EIGS). D’autres butins sont attendus. En effet, le 25 octobre 2025, la même organisation a enlevé deux Égyptiens dont elle facture la libération à 5,8 millions de dollars. Elle détient également des ressortissants chinois, indiens, bosniaques. La forte rançon a, peut-être, été stimulateur d’une autre prise d’otages, survenue huit jours plus tard, le 7 novembre. Les cinq victimes, des expatriés Indiens ont été enlevés alors qu’elles circulaient à Ségou, Mali. Les tractations pour leur libération ont jusqu’ici échoué. L’industrie des enlèvements contre rançons reste donc florissante au Sahel.
Selon un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, les sommes payées pour la libération d’otages au Sahel, entre 2015 et 2025, dépassent 400 millions de dollars et alimentent directement la résilience des réseaux djihadistes. Des otages ont été exécutés, après le refus de paiement. Ainsi, Edwin Dyer, otage britannique et un ressortissant suisse ont été tués, en décembre 2009, par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), dans le nord du Niger. Il en fut de même en 2010, quand la France ne paya pas AQMI pour libérer l’ingénieur Nicolas Germaneau. Le débat entre partisans et adversaires du paiement de rançons a connu son paroxysme, en 2003. Cette année-là, un groupe de 14 otages européens avait été enlevé en Algérie: neuf Allemands, quatre Suisses et un Néerlandais. Détenus pendant huit mois, ils avaient, après négociations, été élargis dans le nord-est du Mali.
Le paiement de rançons permet de négocier la libération de combattants et de personnalités proches de djihadistes. A travers les pourparlers, il s’assimile aussi à une reconnaissance, nationale et internationale. Les preneurs d’otages tissent ainsi des liens à l’international. Ils acquièrent une légitimité, en tant que représentants de leurs mouvements et de leaders nationaux de demain, une stature d’hommes d’État. Et davantage de visibilité médiatique qui accroit leur notoriété auprès de potentiels candidats au djihad, de groupes rivaux et d’une partie de la population. En somme, un outil de publicité pour faciliter les recrutements. Les réseaux sociaux expose leurs faits et vues et encourage ainsi les extrémismes à travers le monde y compris au Sahel.
Les pays qui ont payé des rançons.
Officiellement, et jusqu’en 2012, des pays, dont deux africains, ont accepté, de payer des rançons, afin de libérer leurs ressortissants : Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Madagascar, Pays-Bas, Suisse, Togo. Les rançons vont de 2 millions à un record de 42 millions d’euros.
Tableau 1[i] : Les rançons versées officiellement entre 2003 et 2025
| Année | Pays d’origine | Nombre d’otages | Rançon payée (en millions d’euros) |
| 2003 | Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse | 14 | 4,6 |
| 2008 | Autriche | 02 | 02 |
| Canada | 02 | 03 | |
| 2009 | Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne | 04 | 3,5 |
| Espagne | 03 | 08 | |
| 2010 | France, Madagascar, Togo | 07 | Entre 20 et 42 000 |
| 2011 | Italie, Espagne | 03 | 15 |
| France | 02 | Montant non précisé | |
| 2012 | Suisse | 01 | Montant non précisé |
| 2025 | Émirats Arabes Unis | 03 | 50 et 20 autres en munitions et armes |
Le sort des autres otages
D’autres prises d’otages, entre 2012 et 2025, ont connu d’autres issues, (Tableau 2, ci-dessous):
– assassinats;
– libération, ‘’sans condition’’;
– libération, en échange de celle de prisonniers;
– libération, suite à des combats;
– évasion des otages;
– sort inconnu à ce jour ou en attente.
Tableau 2 : Sort d’autres otages
| Année | Pays | Nombre d’otages | Issue |
| 2013 | France | 02 | Tués (deux journalistes de RFI) |
| 2015 | Roumanie | 01 | Libéré en août 2023 |
| 2016 | Suisse | 01 | Tuée en septembre 2020 |
| États-Unis | 01 | Libéré le 20 mars 2023 | |
| Australie | 02 | Une libérée en février, l’autre en mai 2023 | |
| France | 01 | Relâchée en échange de la libération de
Prisonniers en octobre 2020 |
|
| 2017 | Colombie | 01 | Libérée le 09 octobre 2021 |
| Afrique du Sud | 01 | Libéré le 16 décembre 2023 | |
| Allemagne | 01 | Libéré le 10 décembre 2022 | |
| 2018 | Inde | 01 | Inconnue |
| Afrique du Sud | 01 | Inconnue | |
| Italie | 01 | Libéré le 08 octobre 2020 | |
| Canada et Italie | 02 | Ils s’évadent après 450 jours de captivité,
Le 13 mars 2020 |
|
| 2019 | Canada | 01 | Assassiné |
| France | 02 | Libérés par l’armée française, à l’issue de combat | |
| Italie | 01 | Libéré le 08 octobre 2020 | |
| 2020 | États-Unis | 01 | Libéré par les forces américaines au Nigéria,
Le 31 octobre, après 04 jours de captivité |
| 2021 | France | 01 | Libéré le 20 mars 2021 |
| 2022 | Italie | 03 | Libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024 |
| Allemagne | 01 | Libéré le 26 novembre 2023 | |
| 2025 | Autriche | 01 | Inconnue |
| Espagne | 01 | Libéré le 20 janvier 2025 | |
| Maroc | 04 | Libérés le 04 août 2025 | |
| Suisse – Niger | 01 | Inconnue | |
| Inde | 05 | Inconnue | |
| Iran | 01 | Inconnue | |
| Inde | 03 | Un des otages tué, les deux autres disparus | |
| Égyptiens | 02 | 5,8 réclamés, toujours en négociations après un premier échec |
Ce tableau montre également que les djihadistes privilégient les ressortissants des pays développés occidentaux. L’Inde, l’Iran et l’Égypte sont de nouveaux venus.
Globalement, les paiements de rançons ont plutôt stimulé le terrorisme au Sahel et aiguisé l’appétit de ses leaders. Cette inclinaison a même suscité la création d’un corps de métier : les ‘’négociateurs’’ ou ‘’médiateurs’’ ou encore les ‘’intermédiaires’’. A leur tour, ceux-ci, perçoivent aussi de fortes sommes d’argent, en contrepartie de leurs ‘’prestations’’. Ce sont, en général, des ‘’chefs de tribu’’ maliennes, burkinabè, mauritaniens, nigérianes, nigériennes ou des personnes ressources de leurs entourages respectifs. Pour faire monter leurs factures, ils chargent leurs contraintes : ‘’des dures journées à rouler dans le désert’’, ‘l’attente d’un contact qui va donner, enfin, un rendez-vous, voire juste un autre numéro de téléphone’’, ‘’le marchandage sur le montant de la libération’’, etc. Le débat entre partisans et adversaires des paiements des rançons se poursuivra encore longtemps, au Sahel.
[i] Les deux tableaux ont été établis à partir de données prises dans Wikipédia et d’autres médias.
