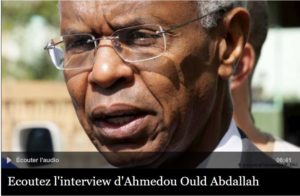Le Sahel à Pau, pensant à Hobbes.
 Au Sahel où le conflit armé dure depuis 2012, le plus grand risque aujourd’hui est ‘’la guerre de tous contre tous’’. Cette situation de guerre civile généralisée, évoquée par Thomas Hobbes au XVII siècle, se profile au Sahel mais existe déjà en Libye.
Au Sahel où le conflit armé dure depuis 2012, le plus grand risque aujourd’hui est ‘’la guerre de tous contre tous’’. Cette situation de guerre civile généralisée, évoquée par Thomas Hobbes au XVII siècle, se profile au Sahel mais existe déjà en Libye.
L’annonce de troupes turques, ou financées par Ankara, rejoignant sur le terrain libyen celles soutenues par d’autres états du Moyen orient, mène vers l’anarchie décrite par Hobbes. Elle peut inquiéter mais ne saurait surprendre les pays du Sahel qui doivent, avec leur allié français se réunir le lundi à Pau, France.


 Le Poste militaire avancé d’Inatès, dans le Sud-ouest du Niger, à sa frontière avec le Mali, a été attaqué, le 10 décembre 2019, causant la perte de soixante-et-onze (71) militaires nigériens. Le terrible bilan a provoqué des coups de colère dans ce pays. Parmi les réactions, celles d’acteurs centraux de la vie politique du pays ont montré sur quoi se fonde leur doute quant à l’utilité des bases militaires installées au Sahel : le fait qu’elles ne fournissent pas toujours des informations sur les mouvements des djihadistes, aux moments critiques, aux forces armées des pays hôtes. Leur lenteur de réaction est aussi décriée, quand elles sont informées de combats en cours. Ces informations, stratégiques, permettraient aux armées du G5 de prévenir les assauts des djihadistes. La surveillance des territoires ne peut être efficace que si des procédés électroniques sont utilisés, au regard de l’étendue de l’espace à défendre et au vu de la dynamique des allers et venues des terroristes. Les Américains sont leaders dans cette technologie et en vendent aux Français.
Le Poste militaire avancé d’Inatès, dans le Sud-ouest du Niger, à sa frontière avec le Mali, a été attaqué, le 10 décembre 2019, causant la perte de soixante-et-onze (71) militaires nigériens. Le terrible bilan a provoqué des coups de colère dans ce pays. Parmi les réactions, celles d’acteurs centraux de la vie politique du pays ont montré sur quoi se fonde leur doute quant à l’utilité des bases militaires installées au Sahel : le fait qu’elles ne fournissent pas toujours des informations sur les mouvements des djihadistes, aux moments critiques, aux forces armées des pays hôtes. Leur lenteur de réaction est aussi décriée, quand elles sont informées de combats en cours. Ces informations, stratégiques, permettraient aux armées du G5 de prévenir les assauts des djihadistes. La surveillance des territoires ne peut être efficace que si des procédés électroniques sont utilisés, au regard de l’étendue de l’espace à défendre et au vu de la dynamique des allers et venues des terroristes. Les Américains sont leaders dans cette technologie et en vendent aux Français. Le Niger sous le choc après la mort de 71 soldats dans l’attaque d’Inates et la région du Sahel, sur le qui-vive, cherche une réponse plus efficace aux assauts répétés des groupes armés.
Le Niger sous le choc après la mort de 71 soldats dans l’attaque d’Inates et la région du Sahel, sur le qui-vive, cherche une réponse plus efficace aux assauts répétés des groupes armés.  Le terrorisme sahélien prend de l’ampleur et gagne de nouveaux territoires. Il fait peser dangereusement le curseur de la terreur sur le Golfe de Guinée. La montée des actes d’intolérance confessionnelle et la problématique structurelle auxquels font face nombreux Etats côtiers pourraient constituer un ressort de l’enracinement de la violence terroriste. Ostensiblement, au Sahel, le péril terroriste montre de plus en plus l’itinéraire de son expansion, mais brouille conséquemment la posture opérationnelle des Etats, du fait, notamment, de l’hybridation de ses méthodes ; entre prise en charge des frustrations populaires, enseignement de la haine et diffusion des théories de la conspiration.
Le terrorisme sahélien prend de l’ampleur et gagne de nouveaux territoires. Il fait peser dangereusement le curseur de la terreur sur le Golfe de Guinée. La montée des actes d’intolérance confessionnelle et la problématique structurelle auxquels font face nombreux Etats côtiers pourraient constituer un ressort de l’enracinement de la violence terroriste. Ostensiblement, au Sahel, le péril terroriste montre de plus en plus l’itinéraire de son expansion, mais brouille conséquemment la posture opérationnelle des Etats, du fait, notamment, de l’hybridation de ses méthodes ; entre prise en charge des frustrations populaires, enseignement de la haine et diffusion des théories de la conspiration. Le concept de “forces de maintien de la paix” de l’ONU déployées en Afrique est devenu totalement obsolète, estime un ancien haut fonctionnaire de l’ONU.
Le concept de “forces de maintien de la paix” de l’ONU déployées en Afrique est devenu totalement obsolète, estime un ancien haut fonctionnaire de l’ONU.